Les montages magiques d'Hédi
- font size decrease font size increase font size
 A droite : les années 20, la montée du fascisme à Londres, un ancien colonel de l’armée, un fait divers et du Savoir-vivre. A gauche : l’année 2008, des notes, des croquis et des Pierres qui montent. Au centre : Hédi Kaddour, 64 ans, agrégé de lettres, pas beaucoup de kilos et auteur d’un seul et imposant premier roman, Waltenberg. En publiant simultanément son deuxième et un journal de notes, il démontre grâce à son art du montage, qu’en matière de littérature, il fait preuve d’un trop rare et très élégant savoir-faire…
A droite : les années 20, la montée du fascisme à Londres, un ancien colonel de l’armée, un fait divers et du Savoir-vivre. A gauche : l’année 2008, des notes, des croquis et des Pierres qui montent. Au centre : Hédi Kaddour, 64 ans, agrégé de lettres, pas beaucoup de kilos et auteur d’un seul et imposant premier roman, Waltenberg. En publiant simultanément son deuxième et un journal de notes, il démontre grâce à son art du montage, qu’en matière de littérature, il fait preuve d’un trop rare et très élégant savoir-faire…
Vous publiez coup sur coup un journal et un roman, à la genèse commune. Cinq ans après Waltenberg, c’est votre nouveau défi littéraire?
L’idée était effectivement de se donner un défi. Dans Waltenberg, il concernait la masse critique, s’obliger à atteindre un tel volume qu'il échapperait au contrôle initial. Ce qui est intéressant c’est que le livre se met à ressembler à autre chose que l'intention première. Finalement c’est très grave quand un livre ressemble à son intention première, ça veut dire qu’il n’a pas été "inventé". Qu’allais-je faire ensuite ? J’avais envie de tenter autre chose. En 2007, j’annonce dans la NRF que je suis en train d’écrire un nouveau gros « livre improbable ». Dans mon esprit c’était un journal, à l’intérieur duquel un récit se serait déroulé par épisodes, comme un roman feuilleton de presse quotidienne. J’y voyais là l’occasion de construire quelque chose d’un peu singulier, un nouvel objet à créer.
Et pourtant ce sont bien deux ouvrages que vous publiez…
J’avançais dans la construction de ce livre improbable et, au bout de deux mois, je l’ai fait lire et les retours étaient les mêmes : les deux modes de lecture avaient tendance à se combattre. Ils étaient contradictoires. Ma première réaction a été, comme d’habitude, de passer outre. Je me suis ensuite rendu compte que, si je voulais en faire vraiment une œuvre, ça demanderait beaucoup de travail de précision pour que la nécessité apparaisse, une nécessité de composition en filigrane. Si je voulais faire ce travail là, cela devenait un travail démesuré de sept ou huit ans. Je n’en ai pas eu l’envie. J’ai donc sorti le récit que j’ai travaillé comme un roman court et j’ai continué parallèlement à écrire le journal. Ils ont donc été écrit ensemble et sortent ensemble.
C’est l’interaction du réel sur de la fiction ?
Il y a quelques universitaires qui se sont lancés sur cette piste pour voir quelles étaient les interactions sous-jacentes entre le journal et le roman. Il y a effectivement des points de jonction. J’ai l’habitude de prendre des notes, tout le temps. Dans Waltenberg, je les avais versées dans le récit. Quand j’arrive à faire une journée correcte -que je travaille depuis le matin jusqu’à 3 ou 4 heures de l’après midi- le texte finit par me réclamer de la nourriture. Je vais donc à la pêche, dehors. Et quelquefois j’ai de la chance, je trouve des choses que je réaménage, que j’insère… Quelques notes sont passées dans le roman mais l’essentiel constitue les notes du journal.
Savoir-vivre est inspiré par un fait divers assez singulier, comment l’avez-vous découvert ?
C’est un fait divers que j’avais trouvé à la British Library dans la presse britannique, dans le Daily Mail, le Sunday Dispatch... A l’époque ça avait fait entre trois et cinq colonnes à la une dans tous les journaux. Quand l’affaire a été jugée un an et demi après, la presse en a à nouveau parlé et puis l’affaire a complètement disparu. Quand j’écrivais Waltenberg j’avais essayé d'y placer cette histoire mais elle avait tendance à prendre trop de place. Je l’avais retirée en me disant que j’en ferais quelque chose d’autre. Je l’ai reprise pour en faire donc le récit inséré au journal.
Une fois sortie du journal, que ça a cessé d’être des séquences de récit, il s’est posé un problème important : je connaissais le coup de théâtre de la fin mais l’allant et le désir n’y étaient pas, ce qui est grave quand vous écrivez. Donc j’ai essayé de mettre un couple de personnages autour des deux protagonistes qui les regarderaient vivre mais cela n’apportait pas grand chose. Et puis, un après midi, j’ai pris deux personnages de Waltenberg, Max et Lena et c’est parti tout seul. Comme si cette histoire-là se souvenait des conditions dans lesquelles elle avait été prévue.
Vous inscrivez Savoir-vivre dans l’entre-deux-guerres avec un regard précis sur cette époque, quelle est la différence entre le travail du romancier et celui de l’historien ?
Toutes les époques sont des périodes-clefs mais celle-ci l’est particulièrement. Une meilleure connaissance de l’entre-deux-guerres nous permettrait d’éviter quelques bêtises. J’ai un goût pour l’enquête historique. Thomas Mann dit dans le prologue de la Montagne magique que l’un des travaux du romancier est de gratter la rouille historique. C’est un travail passionnant de reconstituer ce que pouvait être la couleur, le timbre d’une époque. Il y a tout un travail d’enquête mais il ne faut pas non plus que le roman sente la fiche. C’est toute la difficulté, il faut élaguer et ne garder que les pointes. Choisir des détails précis pour que l’on se sente dans l’époque.
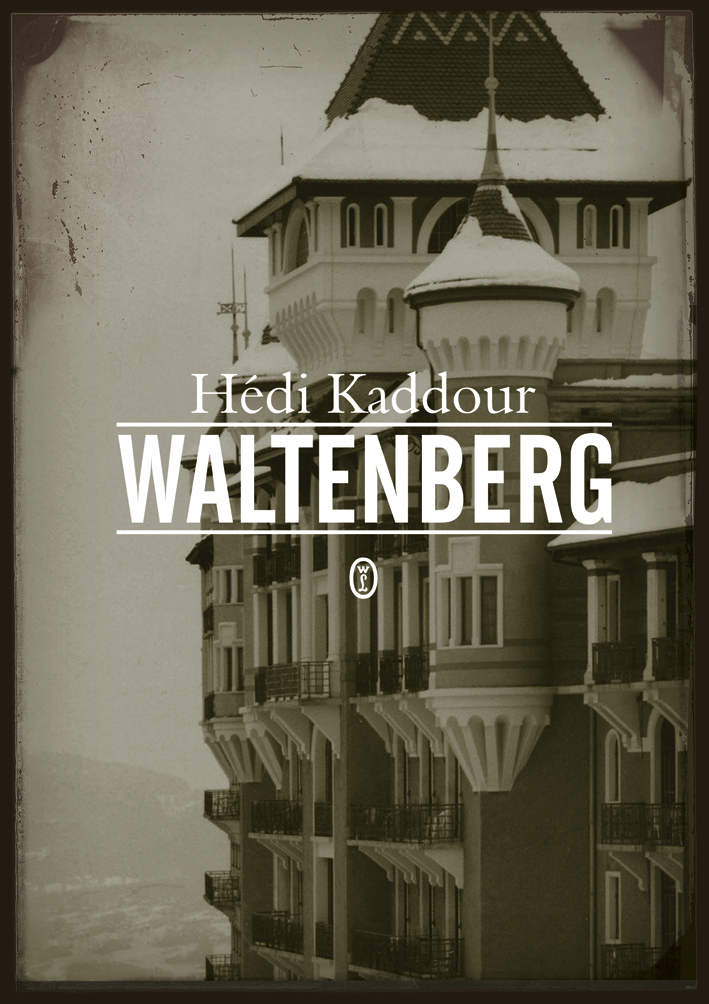 Avec ce cadre historique, l’utilisation de la musique ou la mécanique implacable du coup de théâtre, vous semblez vous obliger à beaucoup d’exigences…
Avec ce cadre historique, l’utilisation de la musique ou la mécanique implacable du coup de théâtre, vous semblez vous obliger à beaucoup d’exigences…
J’ai un goût majeur pour la musique de chambre, le type de musique qui a le plus d’exigence. Concernant Savoir-vivre, je voulais mettre la mise en scène du désir - en particulier féminin quand on est un bonhomme - et celle de la musique. Je me suis toujours dit que si j’arrivais à faire entrer la musique dans un roman, ma phrase y gagnerait. C’est pour cela qu’il y a cette représentation de ce qui peut se passer lors d’une répétition entre une cantatrice et son pianiste. Il faut être précis et rapide. La musique devient un enjeu. Mais c’est vrai que si vous choisissez de mettre une répétition de musique de chambre dans un roman, vous renoncez à un zéro au tirage: il vaut mieux mettre une scène un peu hard dans les toilettes d’un TGV pour gonfler le tirage.
Toute la matière dans votre carnet ne provoque-t-elle pas un sentiment de frustration…Une sorte de renoncement à des dizaines de romans potentiels ?
A l’intérieur, il y a de petits récits, de petites scènes, mais je voulais tenter de faire un journal. Pas un journal de diariste - qui serait l’atelier d’un travail en cours - mais quelque chose qui rassemblerait les notes qui me sembleraient devoir être publiées. Je me promène dans la rue, un peu comme les photographes qui ont un "œil cadre" : ils voient des choses qu’on ne voit pas parce que leur œil porte déjà le cadre. Je sors donc dans la rue avec une phrase en manque qui cherche de quoi se nourrir. Quand on trouve des choses dans le réel, on peut en inventer du même ordre dans la fiction. Ce sont l’avers et le revers des mêmes données, quelque chose qui relève de l’extraordinaire mais qui a en même temps sa nécessité. Le journal en tant que tel, si je devais sortir tout ce qui a été écrit dans mon éphéméride, comprendrait 950 pages. Le travail sur ces notes a été essentiellement un travail d’élagage. C’est la coupe qui reste le travail de composition le plus important. J’ai eu des périodes où j’avais beaucoup de notes de littérature d’après les cours que j’avais à faire. Il a fallu enlever certains cours, certains auteurs pour ne garder que ce qui pouvait céder la place à une note de spectacle, une note de film ou une note de passant du petit récit au trait d’une ligne plus serrée encore que le Haïku. La composition, on la retrouve ainsi dans le journal par le montage pour obtenir des effets d’échos, d’assonances. C’est pour cette raison que je l’ai appelé Notes et croquis.
Un carnet, un stylo et vous notez en extérieur avant de monter au bureau, ça a quelque chose à voir avec le cinéaste ?
Ça a effectivement quelque chose à voir avec le cinéma. Godard disait que la grande question du montage était de savoir où faire passer la coupure. Dans le journal, j’ai passé mon temps à ça. C’est comme ça que je suis passé de 950 pages à un peu plus de 350. Il y a ce sujet, une très belle formule d’Adorno dans les Minima Moralia : « un texte peut avoir la force de ce qu’on lui enlève ». Il y a un équilibre à trouver.
Le journal est peut être l’exercice le plus simple et le plus évident à faire pour un écrivain, mais peut-être aussi le plus difficile à réussir…
J’ai mis à l’intérieur cette citation de Drieu : « Le journal est la lâcheté de l’écrivain ». Dans mon esprit, ce qui caractérise le travail de l’écrivain, c’est la composition d’une œuvre. Je pense que la littérature a quelque chose de très sérieux à voir avec l’œuvre d’art. Dans le journal, on escamote un peu cette nécessité folle de la composition et pour l'essentiel, on s’en remet au rythme des jours. C’est donc l’éphéméride qui fait avancer. Drieu parlait de cette lâcheté de l’écrivain parce qu’en faisant un journal, il contourne, au moins dans un premier temps, sa tâche de composition.
Si la littérature a quelque chose à voir avec une œuvre d’art, l’écrivain a-t-il quelque chose à voir avec un artiste ?
Il n’y a rien de magique dans l’écriture. Il faut avoir d’abord un désir très fort, un élan, quelque chose à raconter. Ensuite c’est du savoir-faire d’atelier, de l’artisanat. Il faut toujours faire attention en littérature. Ce qui est premier doit être la qualité de la texture. Aujourd’hui dans le tout venant de la littérature, on a le sentiment que cette notion de mise à l’épreuve de la texture ne se fait pas. Ce qui n’arrivait pas avec la génération Flaubert, Goncourt, Gautier, Maupassant parce que c’étaient des écrivains qui discutaient entre eux et qui était capables de s’engueuler tout un après-midi sur une métaphore. On a l’impression que c’est superfétatoire mais en réalité, ça rendait compte de la qualité de la prose de l’époque. La grande difficulté est qu’on en vient à passer pour des grands vins des boissons qui relèvent du Beaujolais nouveau. Si vous êtes chroniqueur dans une revue de vin et que vous essayez de faire passer ce Beaujolais pour un grand Sauternes, vous allez vous décrédibiliser d’un instant à l’autre. En littérature vous pouvez vous amuser à faire ça, personne ne vous en tiendra rigueur. La grande différence avec les vins est qu’il y a une différence de prix entre un grand Sauternes et un Beaujolais nouveau. En littérature, la piquette et le grand cru ont le même prix. L’exigence critique devrait donc être encore plus forte. Mais en même temps, je ne veux surtout pas vitupérer l’époque. Il y a de formidables romans contemporains avec une ambition véritable comme le roman de Vincent Message. Je ne suis pas non plus dans le crépusculaire avec la fin de la littérature. D’ailleurs c’est un topo assez stupide que n’importe quel chercheur va retrouver au début du romantisme, au début du réalisme…
A l’intérieur de vos notes vous expliquez qu’il y a chez tout le monde « deux heures de conneries incompressibles », comment les occupez-vous ?
C’est ce qui m’a réconcilié avec la télévision. Comme nous avons tous dans la journée deux heures de conneries incompressibles, autant les passer devant des feuilletons comme les Experts. Même si les techniques sont parfois de pacotille avec des champ / contre-champ, ils restent tout de même assez bien faits avec d’intéressantes trouvailles dans l’intrigue. Ils ont en réalité une fonction cathartique. Je n’y passe pas deux heures mais un épisode de temps en temps… En revanche il existe des séries de grande qualité comme The Wire ou The West Wing.
Au final, que reste-t-il du poète ?
Au fond mon activité fondamentale est la prise de notes. J’ai toujours pris des notes. J’ai toujours cherché ce qui pouvait faire note. Pendant longtemps j’en ai fait des poèmes. Un jour quand je suis rentré de ma sortie, j’ai décidé d’écrire un gros roman qui serait la collision des Trois mousquetaires et de la Montagne magique. J’ai continué à prendre des notes qui dorénavant ont basculé dans le roman. Grâce à la poésie on devient exigeant sur le rythme, la justesse, le rôle de l’implicite ou de l’ellipse. Dans un roman, on n’en joue pas autant que dans un poème mais ils continuent à être présents. Il faut être capable de refuser l’éditorial et laisser parler le montage.
Propos recueillis par Charles Patin O'Coohoon
Photo: Hélie Gallimard
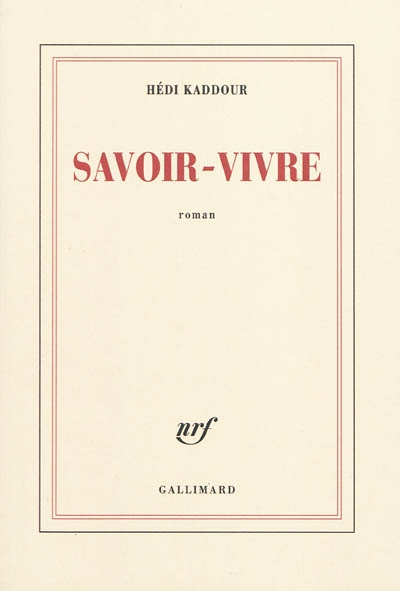 Hedi Kaddour
Hedi Kaddour
Savoir-vivre
Ed. Gallimard
197 p. - 14,40 €
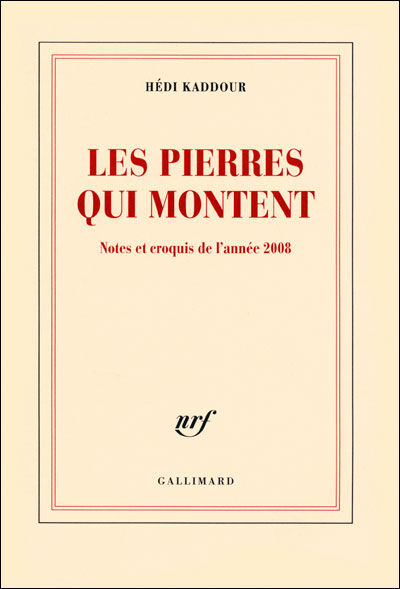 Hedi Kaddour
Hedi Kaddour
Les pierres qui montent
Ed. Gallimard
378 p. - 20 €