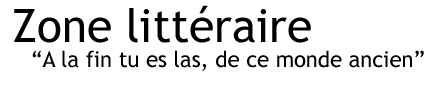On lit dans votre biographie que vous avez été journaliste : comme votre héros, Grand, vous vous occupiez de la rubrique des faits divers ?
Exclusivement ! On a bien essayé deux fois de me faire changer mais en vain. L’une d’elle était pour interviewer des vedettes de l’époque, type Jeanne Mas ou C. Jérôme mais très franchement, ça n’avait pas beaucoup d’intérêt. Sauf la fois où j’ai rencontré Charles Aznavour, pour qui j’avais déjà un peu plus de respect. Encore qu’on ne devrait jamais rencontrer les gens qu’on admire, on est toujours un peu déçu, ils ne ressemblent pas forcément à leur œuvre. Si au moins on vous demandait de rapporter l’intégralité de
l’entretien, ce qui aurait pu avoir de l’intérêt, mais n’évoquer que son dernier divorce et son fibrome, franchement, je n’en avais rien à foutre ! Lire encore ce genre de trucs, bon, mais l’écrire, non ! Au contraire, dans le fait divers, vous êtes confrontés à une histoire réelle, avec de vrais personnages. Vous découvrez surtout un autre monde… C’est particulier.
Dans votre livre, Grand, envoyé pour couvrir une banale affaire, va la grossir afin de rester plus longtemps sur les lieux, le temps de séduire une femme rencontrée sur place. L’affaire devient nationale. La modification des faits est une pratique courante dans ce métier ?
Oui et non. Par exemple, l’épisode des faux charniers de Timisoara que je raconte est vrai. La Tous les journalistes présents ont dit qu’ils sentaient l’arnaque, ils ont envoyé quand même les images à leurs rédactions en les prévenant de leurs doutes. Mais la chaîne 5 a diffusé et tout le monde a suivi. Pour ensuite dire trois semaines plus tard que c’était de l’arnaque alors qu’ils le savaient déjà plus ou moins. C’est un peu le propos du livre d’ailleurs, ne nous leurrons pas, les journalistes aujourd’hui sont là pour vendre de l’info. Il y par exemple deux façons de filmer une manif : soit en grand angle, auquel cas on voit des types en rang compact au milieu d’un grande avenue – impression qu’il y avait 300 pelés à tout casser - soit en resserrant le cadre, où là, au contraire, on ne voit pas le bout, les contours de la foule : impression cette fois qu’ il y avait du monde ! dans les deux cas on parle toujours d’une manif, mais on en donne une vision très différente. Vous ne mentez pas donc ! Bien souvent, on n’avait pas besoin d’inventer, il suffisait de mettre en avant un trait. C’est pour ça que j’ai arrêté le journalisme. On ne m’a jamais demandé de mentir, mais de ne pas ramener toute la vérité. Ce n’est pas pareil. En ce cas, ce que vous dites n’est pas faux mais vous en donnez une vision incomplète.
En même temps vous saviez très bien que si vous aviez donné l’histoire dans sa globalité, les gens aurait zappé ou pas acheté votre journal. Car ce n’est pas que de la faute des journalistes. Nous téléspectateurs ou lecteurs, on a envie que ça vibre, qu’il y ait du sang, qu’on soit ému… Aujourd’hui, le métier de journaliste c’est de vendre de l’info, pas d’aller la chercher.
Vous en parlez, qu’est-ce qui justement selon vous explique la fascination des gens pour les faits divers, « tous ces articles que l’on lit avec délice et qu’on oublie aussi vite »
D’abord, depuis longtemps, notre société a totalement gommée la mort, on en parle très peu, d’ailleurs on est souvent désarmé face à la mort d’un proche, n’ayant plus tous ces rites d’avant. Dans les faits divers, on montre des morts, qui ne sont en plus pas les vôtres, ce qui permet une distance. Ensuite, il y a l’attrait du sang. Demain remettez les jeux du cirque, vous verrez l’audience ! C’est humain, on a tous une part de cruauté. Enfin, c’est beaucoup plus facile de discuter du malheur que du bonheur. Le bonheur, on le vit tous de la même manière. Alors que le malheur, c’est souvent des histoires
abracadabrantes, on a envie d’en parler. il y a du sang, et puis la mort. Un polar fera toujours de l’audience à la télé. Pourquoi Le Silence des Agneaux a t-il lancé une mode des films sur les tueurs en série ? Parce qu’il y a du monde pour les voir. Et pourquoi ?
Parce que c’est le mal identifié. Et puis bon, c’est toujours agréables de savoir qu’il y en a qui sont plus dans la merde que nous !
dans Le 18 vous évoquiez la vie d’une caserne de pompiers : il y a des point communs avec les faits divers…
Oui, la mort ! D’abord parce qu’ils la risquent souvent dans leurs interventions. Aussi parce qu’ils y sont confrontés. Ils font face à la misère humaine en permanence. Les Baltringues c’était aussi ça, la misère et la mort.
C’est votre propre expérience chez les pompiers qui vous a marqué ?
Non, ma fascination pour la misère et la mort est bien antérieure. Je suis né dans un univers très bourgeois, très protégé, mes parents avaient un hôtel particulier près du parc Monceau, et dans mon enfance je fréquentais donc les enfants de mes parents. Très
rapidement j’ai été choqué par leur vision de l’existence, je ne veux pas dire que j’étais différent mais j’avais conscience d’être d’un milieu privilégié. Pour moi, cela me donnait des devoirs, pas des droits. Pour eux, c’était l’inverse ! Toujours est-il que j’ai été assez vite attiré par la découverte de ceux qui n’avaient pas eu ma chance, et en fait j’ai trouvé plus d’humanité dans la misère que chez les autres. C’est sans doute pour cela que j’ai écrit ces bouquins. J’en parle aujourd’hui avec du recul mais ce n’était pas un choix conscient. C’est ces personnages là que j’avais envie de mettre en avant en tous cas.
Pour en revenir aux Chiens écrasés, le grossissement de l’affaire par les journalistes va finir par coûter la vie à l’un des protagonistes. Or, votre héros réussit à avoir la fille qu’il tentait de séduire. Je vous avoue, je vous ai trouvé assez gentil avec lui !
Mais parce qu’il n’est pas responsable ! Lui il se dit, je vais inventer ça et ça n’intéressera de personne. Comment peut-il imaginer que lorsqu’il aura inventé Zizigougou ça va passionner les foules ? Il n’a pas encore compris qu’il n’y a que les conneries qui
intéressent les gens ! En réalité, ce qu’il gagne là dedans, ce n’est pas vraiment la fille (d’ailleurs on ne sait pas vraiment si c’est le cas) mais c’est la conscience qu’il doit s’engager dans ce qu’il fait. Et il arrête de s’appeler Grand pour avoir un prénom. Il devient soudain un individu.
Et puis il ne faut pas toujours des fins dramatiques. Bon,franchement, à la place de la fille, un type qui invente un truc aussi débile juste pour avoir le temps de vous draguer, vous lui
laissez sa chance. Même s’il est très maladroit, il a essayé !
La littérature ne manque pas d’exemples d’écrivains s’inspirant de faits divers pour nourrir leur œuvre, plus récemment Emmanuel Carrère avec L’Adversaire sur le faux médecin meurtrier Roman, ou Philippe Besson venant de sortir un livre sur l’affaire du
petit Grégory. La réalité semble souvent dépasser la fiction, ça veut dire qu’on ne laisse plus part à l’imagination ? Ou au contraire, c’est une transfiguration du réel ?
Pour moi, même basé sur un fait réel, le roman reste une œuvre originale. Ce qui fait l’originalité c’est pas l’idée, mais le traitement. Il y a très peu d’histoires vraiment originales en fait. Je peux très bien comprendre que Carrère ait été séduit par l’histoire hallucinante de Roman. Moi, je connais celle à Strasbourg d’un type qui, ayant été refusé pour intégrer la police, s’accusa plus tard d’un meurtre, disant une fois qu’on découvrit
son innocence – au bout de plusieurs mois de prison préventive ! – qu’il préférerait « passer pour un meurtrier que pour un crétin ». Juste pour emmerder la gendarmerie. Je trouve que c’est un bon sujet de roman, encore faut-il être capable de l’écrire… Raconter l’histoire de Roman, en 5 minutes, c’est génial. Mais faites la tenir sur trois cent pages alors que tout le monde connaît la fin, là c’est du talent, original.
Les Chiens écrasés, Ludovic Roubaudi, éditions le Dilettante, 16 euros.
Maïa Gabily
Ludovic Roubaudi
Ed.
0 p / 0 €
ISBN: