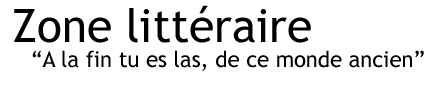Après Open Space, Le Pied mécanique est le deuxième roman de Joshua Ferris. Repéré par le New Yorker, il figurait sur la dernière liste des « 20 under 40 », distinguant les écrivains dont le travail mérite d'être suivi, aux côtés, entre autres, de Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Salvatore Scibona, Téa Obreht, Dinaw Mengestu... Dans Le Pied mécanique, il suit la trajectoire d'un homme atteint d'un mal étrange : son corps lui impose de marcher des kilomètres durant, jusqu'à l'épuisement, sans qu'il puisse y résister. Un mal qui bouleverse sa vie professionnelle et familiale... Rencontre avec cet Américain curieux qui a fait le choix de s'expatrier pendant un an et de résider dans l'Italie voisine afin de changer de point de vue et d'élargir son champ de réflexion...
Vous aviez ancré votre précédent roman dans le milieu publicitaire, que vous connaissiez bien puisque vous y avez vous-même travaillé. Dans Le Pied mécanique, le travail occupe également une place centrale dans la vie du héros, qui est avocat. Comment avez-vous fait le choix de cette profession et quelle importance accordez-vous au travail comme élément structurant vos personnages ?
Je dirais que je m'intéresse avant tout au choix que font les gens pour gagner leur vie et à la façon dont le travail les affecte, les définit dans la mesure où c'est ce à quoi l'on consacre une grande partie de son temps au quotidien. Si je connaissais bien le milieu publicitaire, j'ai aussi un bon aperçu de la manière dont travaillent les avocats puisque ma femme en est une ! Mais, davantage que le métier en lui-même, ce qui m'intéressait était la façon dont le travail forge, déteint, modèle les hommes. Et ceci de façon générale, pas seulement dans mes livres. Je pense c'est quelque chose qui tiendra une place importante dans tous les romans que je pourrai écrire. Parce que le temps est tout ce qu'on a. Lorsqu'il aura disparu, nous serons tous morts. Dès lors, qu'est-ce qui fait que l'on choisit de faire une chose plutôt qu'une autre ?
Si le travail occupe une place centrale dans l'existence de vos personnages, elle n'est ne semble pas toujours positive : il tend parfois à occuper une place démesurée, débordant sur l'espace privé de façon néfaste. Peut-on voir dans votre livre une critique du mode de vie moderne ?
Tim, le personnage principal, est obsédé par son travail. Et lorsqu'il ne peut plus travailler, une grande partie de sa vie lui échappe. Que faire alors ? Telle est la question. Et je pense qu'on y est confronté que lorsqu'on ne peut plus travailler. Le travail peut ainsi devenir une obsession, une échappatoire vis-à-vis de questions plus difficiles telles que : comment conserver ceux que l'on aime, à quoi est-ce que j'utilise le temps que je passe sur Terre ? C'est la facilité. De la même manière que Jane - la femme de Tim - finit par devenir alcoolique. La boisson est aussi un refuge. Je cherchais à interroger l'évolution des comportements humains lorsque le travail n'est plus disponible.
Par ailleurs, c'est peut-être triste, mais mes personnages sont aussi des gens extrêmement impliqués, mûs par ce qu'ils aiment. On peut voir quelque chose de mauvais dans le travail, mais aussi du bon en ce que c'est extrêmement motivant. Ce sont les deux revers de la médaille : autant le travail donne un certain sens à votre vie, autant, une fois qu'il disparaît, il laisse un espace vide et nous pousse à nous demander s'il était réellement plus important que notre famille, que nos loisirs, les voyages, ou d'autres expériences encore. C'est une question cruciale. En Amérique, elle devrait être plus souvent posée.
J'ai écrit ce livre avant la grande crise économique mondiale. On réalise à présent que l'argent n'est peut-être pas si important qu'il le semblait puisqu'on n'en a plus autant qu'avant. Pourtant, que va-t-on faire ?
Tim n'est pas le seul à adopter un comportement étrange. Au fil du roman, des phénomènes inhabituels se manifestent, à l'image de ces abeilles qui envahissent subitement le ciel de Manhattan... D'où cette image a-t-elle surgi et que signifie-t-elle pour vous ?
La météo est étrange et la nature très bizarre. Ce dont Tim souffre est un stimulus mystérieux. Je voulais donner au monde environnant un stimulus semblable. Or, actuellement le monde semble malade. Peut-être est-ce le réchauffement climatique. Les débats sont sans fin pour déterminer les causes de ces phénomènes. Mais cela ressemble incontestablement à une mystérieuse maladie : on en ignore le nom, on ne sait pas trop quel diagnostic établir ni comment y remédier. Cela renvoie à la maladie de Tim. C'est la raison pour laquelle j'ai fait intervenir les abeilles, les corbeaux, cette étrange tempête et les feux de forêts. Tim a à la maladie la même relation que le monde entretient avec cette évolution climatique étrange.
En contrepoint au chaos environnant, la famille tient une place importante. Cependant, le modèle que vous proposez rompt avec celui de la famille traditionnelle, unie et stable. Il semble presque que la forme de bonheur atteint par cette famille quelque peu dysfonctionnelle, soit plus authentique que celui qu'une famille plus conventionnelle peut laisser entrevoir...
Je pense que pour être authentique, le bonheur doit être gagné. Le bonheur facile est de peu de valeur et ne va pas durer. Il faut se battre et souffrir dans une certaine mesure pour atteindre un bonheur véritable. Et c'est au travers de ces souffrances et de ses batailles que l'on prend conscience de ce qui a de la valeur, des personnes qui méritent que l'on se batte pour conserver leur affection, et des autres...
Dans le cas de Tim, le bonheur serait l'amour qui émerge du chaos qu'il traverse. Et ceci n'arrive que parce qu'ils ne peuvent plus désormais considérer que l'union avec sa femme va de soi. Ils doivent s'interroger et décider ou non de se battre pour la conserver.
Et dans le cas de Tim, la famille est essentiellement composée de femmes, aux caractères bien affirmés. Avez-vous délibérément accordé cette place à des caractères féminins ? Représentent-elles en enjeu particulier au niveau de l'écriture ?
Je leur accorde de l'importance certainement parce que je suis un homme...
Surtout, les personnages féminins sont amusants à écrire. Je cherche à créer des personnages qui optimisent leur intelligence : leur sensibilité émotionnelle, leur vocabulaire... tout ce qui les définit doit être autant, voire plus, intelligent que ce que je pourrais faire. Je les conçois un peu comme des extensions de moi-même et j'espère qu'ils récupèrent ce qu'il y a de plus intéressant en moi. En ce qui concerne les femmes, elles sont différentes puisque je n'en suis pas une ! C'est donc un jeu littéraire intéressant que je m'efforce de mettre en place, un balancement entre entrer en empathie avec elles, tout en ne comprenant pas tout à leur sujet non plus... Mais je fais au mieux ! Dans mon premier roman, il y avait un personnage féminin très fort. Peut-être cela est-il dû au fait que ma mère était elle-même une femme forte... Mais dans tous les cas, pour être vrais et intéressants les personnages doivent être forts.
Surgit également la question de la normalité, car s'ils sont forts, ces personnages sont également non conventionnels...
Quand on est malade, on se retrouve presque automatiquement rejeté de la société - même quand on n'a qu'un rhume. On se prend à regarder avec agressivité toutes les personnes bien portantes qui nous entourent et l'on se sent un peu exclu. Aussi se sent-on particulièrement solitaire lorsqu'on est atteint d'une maladie qui ne peut être nommée, diagnostiquée ou soignée. Tim commence à agir bizarrement : il porte un sac à dos, des chaussures de randonnée au travail alors qu'il avait l'habitude de porter des chaussures à 500 dollars et un costume... Il en vient même à débarquer avec un casque de vélo sur la tête. Il a donc une apparence extérieure très étrange qui n'a pas sa place dans la société. On ne peut pas être a-normal.
Mais ce comportement est extrême. Il peut y avoir des degrés de bizarrerie intermédiaire. La maladie de Tim doit-elle être vue comme une métaphore, une manière de critiquer les conventions sociales et la façon dont elles orientent notre regard, nous poussant à rejeter tout ce qui a tendance à sortir du cadre ?
Ce n'est pas vraiment une métaphore car Tim a vraiment une allure très étrange. On peut faire de nombreuses lectures métaphoriques du livre, mais j'espère que le roman fonctionne également avec une lecture plus littérale. C'est ce que j'espère avant tout. Je préfère laisser aux lecteurs le soin d'y lire, d'y trouver les métaphores qu'ils souhaitent plutôt que de les leur imposer.
Vous ne parleriez donc pas d'intentions d'écriture qui motiveraient tel ou tel projet en ce qui vous concerne ?
Pas vraiment. En revanche, je pense que si une histoire est bien racontée, des lectures métaphoriques doivent naturellement surgir.
De par les vagabondages de Tim entre le centre et les banlieues, la ville, le motif urbain est omniprésent au point d'agir comme un personnage à part entière, qui souligne les décalages et les écarts sociaux. Quel rapport entretenez-vous avec la ville ?
C'est un lieu de tous les possibles. On peut y faire ce qu'on y veut. Dans une certaine mesure cela nous apporte donc toutes sortes de distractions, ce qui peut être bon ou mauvais parce qu'être en permanence distrait peut vous conduire à oublier des choses plus importantes. Mais le bon côté est que, si l'on est suffisamment ouvert, l'on devient ainsi plus curieux du monde qui nous entoure. Pour moi, la ville est une source de fascination puisqu'elle montre lune grande palette des activités humaines, même si cela n'empêche pas qu'il y ait un tas de choses que les gens font que je ne comprends pas (comme jouer au basketball à Bryant Park, passer la journée à faire du vélo dans Manhattan alors que je passerai plutôt la journée étendu dans Central Park, à lire). La diversité de ces gens m'est donc totalement étrangère. Et c'est pour cette raison qu'ils m'attirent, pas pour y participer mais pour les observer. New York est une ville de 8 millions d'habitants qui font 8 millions de choses différentes. Sa diversité est à la fois belle et effrayante.
Mais un tel mouvement, une telle foule ne peut-elle être considérée comme une forme d'aliénation ?
C'est aliénant pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui agit conformément à la norme. Mais quand on est malade, on est de toute façon mis à l'écart. Avec son activité permanente, New York est la meilleure ville où être quand on est rejeté. Si Tim marche autant, ce n'est pas forcément pour fuir, mais surtout parce que son corps, sur lequel il n'a plus aucun contrôle, le lui commande.
Cette maladie assez surprenante existe-t-elle ou l'avez-vous inventée ?
Je l'ai complètement inventée. Je ne me souviens plus de la façon dont l'idée est venue. Mais ce à quoi l'on pense en premier quand on songe à la maladie est la lente déchéance du corps : le cancer, qu'il faut combattre pour revivre ; Parkinson, qui contraint à utiliser une chaise roulante... Il est souvent question de la dégradation du corps. Paradoxalement toutefois, le cancer est une maladie extrêmement forte et vivace puisque les cellules infectées sont suffisamment fortes pour tuer celles qui sont saines. Je voulais m'intéresser au caractère vivace de cette maladie et l'externaliser dans une certaine mesure, raison pour laquelle son corps est si fort qu'il entraîne Tim.
Son corps reflète un peu l'accélération de l'époque contemporaine, où l'on doit faire toujours plus de choses, toujours plus vite...
Oui, c'est une période extrêmement frénétique. Mais en ce qui concerne le narrateur, son souhait est tout à fait simple : il désire s'asseoir à un bureau, stopper cette frénésie, cette folie, s'asseoir, travailler, lire, ne pas travailler. Le tiraillement réside plutôt entre immobilité et action. Je pense que c'est une description assez exacte du monde moderne : combien de temps accorde-t-on à la réflexion, à la concentration, à faire l'effort d'être patient ? Ce sont des valeurs qui ont tendance à disparaître dans le monde actuel. Tim a donc une maladie très actuelle.
Votre roman comporte des pans scientifiques et juridiques assez précis. Quelle a été votre méthode de travail pour le composer ?
Je me suis documenté à partir de manuels de médecine pour avoir quelques notions et du vocabulaire. Il faut trouver le bon dosage pour être crédible sans être ennuyeux. J'ai donc fait des recherches jusqu'à ce que je pense en savoir suffisamment sur un point. Ensuite, j'avançais sur autre chose. En ce qui concerne les aspects juridiques du roman, je les ai plus acquis sur la durée, en en parlant avec des amis, avec ma femme... De temps à autre je demandais une précision ponctuelle, mais globalement j'avais compris suffisamment de choses pour avoir le sentiment d'être « bilingue » en la matière, pas pour arbitrer une affaire évidemment, mais assez pour savoir quel était le rythme d'un cabinet d'avocats.
Le titre français met l'accent sur le corps tandis que le titre anglais insiste sur la notion d'inconnu. Y a-t-il une dimension qui vous tient le plus à cœur ?
J'apprécie cette traduction ( Le Pied mécanique, traduction littérale d'un poème d'Emily Dickinson) car le vers d'Emily Dickinson est important pour le livre. Mon objectif était de mettre l'accent sur le corps et pointer l'illusion que l'esprit peut avoir d'être libre de sa volonté. Je ne nie absolument pas que l'on air un libre-arbitre, mais il y a des choses que le corps impose auxquelles on ne peut se soustraire : si on a faim, on ne peut l'ignorer ; si on est malade, on devra se coucher pour récupérer ; si on est en surpoids, on devra faire des efforts pour maigrir, sans garantie que ce soit suffisant. Le corps a donc sa volonté propre. On a tendance à penser que la liberté de l'esprit est première, qu'elle est ce qu'il y a de plus instinctif chez l'homme. Alors que je pense qu'elle est bien plus limitée.
D'où la tendance à vouloir réguler les écarts du corps en le médicalisant, le régulant avec différents cachets pour contrer toutes les défaillances...
Oui. Une des idées les plus répandues actuellement est que l'on doit toujours avoir des expériences optimales dans un monde civilisé, riche, qui vous donne les moyens nécessaires : le plus d'argent possible, le plus de bonheur possible etc... Etant donné que c'est rarement le cas, beaucoup de personnes prennent un cachet, ce qui est un réflexe compréhensible. Mais on a tendance à oublier que la médecine continue à être un art, non une science. Reconnaître les limites de l'homme ne pourra qu'apporter plus de bonheur. Mais ce savoir est dur à apprendre. La maladie est un des moyens de l'acquérir.
Quelles sont vos influences? Avez-vous le sentiment d'appartenir à un groupe littéraire ?
Bien sûr qu'il y a des auteurs que j'admire (Beckett et Dickinson entre autres, qui sont des références ouvertes). Toutefois, j'ai surtout le sentiment, comme dans une famille où l'on est liés par des chromosomes communs, d'appartenir à une famille d'écrivains américains qui accordent une place prioritaire au style. Mais il y a aussi des chromosomes qui vous sont plus étrangers, qui font que l'on doit faire son chemin tout seul et trouver sa propre voix. S'il y a
des écrivains dont je me sens proche, je ne pense heureusement pas écrire tout à fait comme ils le font.
Le Pied mécanique
Joshua Ferris
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert
Éditions Jean-Claude Lattès
22 € - 362 p.
 « Ces coups de téléphone que nous craignons tous au milieu de la nuit, à trois heures du matin », Mathias en a reçu un. À l’autre bout du fil, Jeanne ou plutôt son silence, bientôt suivi d’un « c’est Vladimir » à peine perceptible. L’un des trois personnages qui forment, depuis plusieurs années, leur triangle amoureux vient de mourir. Pour accompagner une dernière fois son ami défunt, Mathias décide de prendre le train, de conduire le corps de Vladimir jusqu’à Novossibirsk, en faisant défiler les verres de vodka au rythme des kilomètres, des souvenirs et la campagne sibérienne. Ce voyage en transsibérien, Mathias Enard l’a effectué il y a tout juste un an dans le cadre de l’année France-Russie, en compagnie de plusieurs autres écrivains et poètes français. Pour Zone Littéraire, il remonte dans le temps et dans le train.
« Ces coups de téléphone que nous craignons tous au milieu de la nuit, à trois heures du matin », Mathias en a reçu un. À l’autre bout du fil, Jeanne ou plutôt son silence, bientôt suivi d’un « c’est Vladimir » à peine perceptible. L’un des trois personnages qui forment, depuis plusieurs années, leur triangle amoureux vient de mourir. Pour accompagner une dernière fois son ami défunt, Mathias décide de prendre le train, de conduire le corps de Vladimir jusqu’à Novossibirsk, en faisant défiler les verres de vodka au rythme des kilomètres, des souvenirs et la campagne sibérienne. Ce voyage en transsibérien, Mathias Enard l’a effectué il y a tout juste un an dans le cadre de l’année France-Russie, en compagnie de plusieurs autres écrivains et poètes français. Pour Zone Littéraire, il remonte dans le temps et dans le train.
 Du néant sort peut-être la vérité. Avec ce quatrième roman, Thomas Reverdy se penche sur le destin de plusieurs personnages, morts une première fois le 11 septembre. L’envers du monde, c’est à la fois une quête de rédemption, une réflexion sur l’absence, et une intrigue policière. Un vrai roman en somme. Rencontre.
Du néant sort peut-être la vérité. Avec ce quatrième roman, Thomas Reverdy se penche sur le destin de plusieurs personnages, morts une première fois le 11 septembre. L’envers du monde, c’est à la fois une quête de rédemption, une réflexion sur l’absence, et une intrigue policière. Un vrai roman en somme. Rencontre.
 On dit souvent qu’un parfum est un secret bien gardé, une empreinte personnelle que l’on laisse sur les gens… C’est la première chose qui me saisit quand je rencontre Juliette Jourdan : son parfum, effluve doux et léger qui ne me quittera pas tout au long de l’entretien. Quelques trois heures et un café gourmand plus tard, je suis frappé par autre chose : Juliette s’est réellement confiée… Sur elle-même, sur la « problématique transsexuelle » en France, et sur la littérature surtout. Portrait d’une belle personne et d’une romancière que l’on est fier d’avoir rencontré…
On dit souvent qu’un parfum est un secret bien gardé, une empreinte personnelle que l’on laisse sur les gens… C’est la première chose qui me saisit quand je rencontre Juliette Jourdan : son parfum, effluve doux et léger qui ne me quittera pas tout au long de l’entretien. Quelques trois heures et un café gourmand plus tard, je suis frappé par autre chose : Juliette s’est réellement confiée… Sur elle-même, sur la « problématique transsexuelle » en France, et sur la littérature surtout. Portrait d’une belle personne et d’une romancière que l’on est fier d’avoir rencontré… Après la publication de quatre livres - trois romans et un recueil de poésie - Xabi Molia a investi le terrain cinématographique. Son premier film, Huit fois debout, avec Julie Gayet et Denis Podalydès, vient de sortir en salles. Autour de cette « première », Xabi Molia revient sur son parcours, ses influences, ses doutes et ses (nombreux) projets.
Après la publication de quatre livres - trois romans et un recueil de poésie - Xabi Molia a investi le terrain cinématographique. Son premier film, Huit fois debout, avec Julie Gayet et Denis Podalydès, vient de sortir en salles. Autour de cette « première », Xabi Molia revient sur son parcours, ses influences, ses doutes et ses (nombreux) projets. A droite : les années 20, la montée du fascisme à Londres, un ancien colonel de l’armée, un fait divers et du Savoir-vivre. A gauche : l’année 2008, des notes, des croquis et des Pierres qui montent. Au centre : Hédi Kaddour, 64 ans, agrégé de lettres, pas beaucoup de kilos et auteur d’un seul et imposant premier roman, Waltenberg. En publiant simultanément son deuxième et un journal de notes, il démontre grâce à son art du montage, qu’en matière de littérature, il fait preuve d’un trop rare et très élégant savoir-faire…
A droite : les années 20, la montée du fascisme à Londres, un ancien colonel de l’armée, un fait divers et du Savoir-vivre. A gauche : l’année 2008, des notes, des croquis et des Pierres qui montent. Au centre : Hédi Kaddour, 64 ans, agrégé de lettres, pas beaucoup de kilos et auteur d’un seul et imposant premier roman, Waltenberg. En publiant simultanément son deuxième et un journal de notes, il démontre grâce à son art du montage, qu’en matière de littérature, il fait preuve d’un trop rare et très élégant savoir-faire…
 Cloé Korman est « notre » premier roman. La jeune normalienne et ses Hommes-Couleurs, voyagent ensemble dans le for intérieur de deux pays qui n’en font qu’un. USA-Mexique, ou l’histoire de siamois reliés par le cœur.
Cloé Korman est « notre » premier roman. La jeune normalienne et ses Hommes-Couleurs, voyagent ensemble dans le for intérieur de deux pays qui n’en font qu’un. USA-Mexique, ou l’histoire de siamois reliés par le cœur. Elle est arrivée avant nous, bavarde gaiement avec Patrick Grainville, et nous accueille le sourire aux lèvres. Avant de commencer on partage un verre, elle avoue parler beaucoup... Valentine Goby n’est plus une inconnue dans le paysage littéraire. Depuis 2002, elle fait discrètement son chemin, obtient les saluts de la critique, publie beaucoup, en jeunesse notamment. Son sixième roman, Des corps en silence, nous a tapé dans l’œil. Pour son thème, le désir, pour ses héroïnes, Henriette et Claire qui, à un siècle de distance font face au même effroi : celui qui nous saisit quand le désir dans le couple faillit.
Elle est arrivée avant nous, bavarde gaiement avec Patrick Grainville, et nous accueille le sourire aux lèvres. Avant de commencer on partage un verre, elle avoue parler beaucoup... Valentine Goby n’est plus une inconnue dans le paysage littéraire. Depuis 2002, elle fait discrètement son chemin, obtient les saluts de la critique, publie beaucoup, en jeunesse notamment. Son sixième roman, Des corps en silence, nous a tapé dans l’œil. Pour son thème, le désir, pour ses héroïnes, Henriette et Claire qui, à un siècle de distance font face au même effroi : celui qui nous saisit quand le désir dans le couple faillit.who's online
We have 23 guests and no members online